Retrouvez une liberté de mouvement totale grâce au massage myofascial à Bordeaux Bastide avec la BioTouch Method®
Réflexions sur la végétothérapie et la biodynamique du toucher
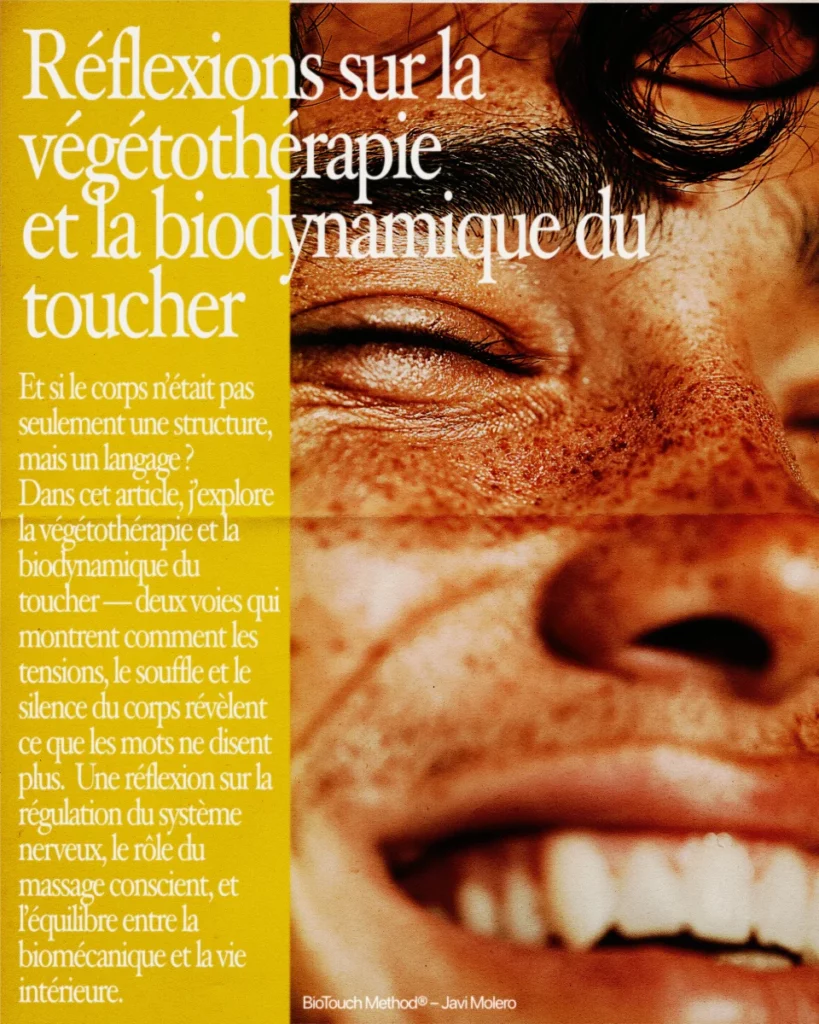
Introduction — Le corps comme langage oublié
Il existe des mots qui n’ont pas besoin d’être prononcés.
Le souffle, la tension, le relâchement, les micro-mouvements du corps les expriment à leur manière, souvent plus sincèrement que le discours.
La végétothérapie caractéro-analytique, initiée par Wilhelm Reich dans les années 1930, a été l’une des premières approches à considérer le corps comme un espace de mémoire inconsciente. Reich y voyait une continuité entre la psyché et le soma : les émotions refoulées ne disparaissent pas, elles s’inscrivent dans la musculature, dans la respiration, dans le tonus de la peau.
Mon intention ici n’est pas de « refaire » de la psychologie, ni de prétendre à une science nouvelle, mais d’observer — par le toucher, la respiration et la présence — comment le corps peut redevenir un lieu d’autorégulation et de compréhension.
1. Le corps comme miroir neurovégétatif
Tout déséquilibre émotionnel ou physique se manifeste dans la respiration et le tonus.
Le système nerveux autonome, composé du sympathique (action, tension, défense) et du parasympathique (repos, intégration, relâchement), régule en permanence cet équilibre.
Lorsqu’un individu traverse un stress chronique, le sympathique domine : le cou se raidit, le thorax se verrouille, le bassin perd sa mobilité. Ces cuirasses musculaires sont les équivalents physiques des défenses psychiques : elles retiennent l’émotion, mais privent aussi le corps de son mouvement naturel.
Dans ma pratique, j’observe comment le massage ciblé et la respiration consciente peuvent rétablir la fluidité de ce système : la peau se réchauffe, le souffle s’allonge, les tissus se réorganisent.
Le relâchement tissulaire ne se limite pas à la mécanique ; il ouvre un espace de confiance où le système neurovégétatif retrouve sa cohérence.
2. Le silence du cabinet : la parole du souffle
Le silence, dans une séance, n’est pas vide.
C’est un espace de communication subtile où le mental s’efface et où la respiration devient le seul dialogue nécessaire.
Lorsqu’un client entre dans une détente profonde, le corps commence à « parler ». Ce sont des soupirs, des tremblements, des mouvements involontaires, parfois des larmes silencieuses. Le praticien n’interprète pas ; il écoute avec les mains.
Ce moment de bascule — entre relâchement et ouverture — est peut-être la forme la plus pure de la biodynamique : l’énergie vitale, ou « végétative », reprend son cours naturel, sans contrainte ni volonté.
Gerda Boyesen décrivait ce phénomène par la notion de psychopéristaltisme : ces sons ventraux discrets qui signalent une digestion émotionnelle, la libération du système nerveux autonome.
C’est là, dans ce silence vivant, que la thérapie corporelle rejoint la méditation.
3. La dynamique céphalocaudale : descendre du mental vers la base
Reich observait que la tension émotionnelle s’organise selon une séquence céphalocaudale — de la tête au bassin. Chaque segment musculaire, lorsqu’il se libère, permet au suivant de se détendre à son tour.
Cette descente est à la fois physiologique et symbolique : elle traduit le passage du contrôle vers la confiance, du mental vers le ressenti.
En travaillant la respiration, le thorax, le diaphragme, puis le bassin, le corps retrouve peu à peu son axe, sa verticalité, son ancrage.
Dans une séance, cela se manifeste par une respiration plus profonde, une chaleur diffuse, parfois une émotion inattendue.
Le thérapeute n’impose rien : il accompagne ce mouvement descendant, cette décompression du système nerveux qui rend à l’énergie sa direction naturelle — vers la terre, vers le réel.
4. Le toucher comme voie d’autorégulation
Je ne considère pas le massage comme un acte purement physique.
Il est une interface : 50 % mécanique, 50 % énergétique.
Chaque geste crée un signal mécanique, mais aussi un échange sensoriel et bioénergétique. Le corps du praticien et celui du client communiquent à travers le champ neurovégétatif, une forme d’écoute tissulaire.
Quand la main se pose au bon endroit — ni trop, ni trop peu — le corps répond par un relâchement réflexe. La respiration change, la peau s’irise, parfois une parole surgit.
Ce n’est pas une “guérison”, mais une autorégulation : le corps se souvient de sa capacité à se calmer, à se recentrer, à se réorganiser.
C’est là que réside, selon moi, la beauté du métier : observer ce moment où la physiologie rejoint la conscience, où le système nerveux se réaligne sans effort, comme un instrument qui se réaccorde.
5. Entre Occident et Orient : deux chemins vers la même sagesse
Dans les traditions indiennes, notamment l’Ayurveda et le Yoga Chikitsa, le corps est aussi un lieu de transformation intérieure.
Les Marma points de la médecine ayurvédique correspondent aux zones de jonction entre structure, souffle et esprit — très proches des points de Reich ou de Boyesen.
L’objectif est le même : rétablir la circulation du prāṇa, l’énergie vitale, et restaurer l’unité entre respiration, mouvement et conscience.
Les approches occidentales et orientales utilisent des langages différents, mais elles parlent du même phénomène : le corps comme interface de régulation entre psyché et énergie vitale.
Dans mon approche BioTouch Method®, cette rencontre devient une pratique :
– écouter les tissus comme un psychologue écouterait une parole,
– suivre la respiration comme un yogi suivrait le souffle,
– et offrir au corps l’espace de se rappeler ce qu’il sait déjà : s’équilibrer.
6. L’art d’agir avec justesse
Dans la thérapie corporelle, la force n’est jamais la solution.
Le geste juste, c’est celui qui respecte la logique du vivant : le moment, la direction, le rythme.
On ne pratique pas un deep tissue sur un muscle actif, pas plus qu’on ne cherche à libérer une émotion : on permet simplement au corps de le faire, s’il est prêt.
Le thérapeute n’est ni médecin ni psychologue ; il est passeur, celui qui crée la condition du mouvement intérieur.
Quand cette confiance s’installe, quelque chose d’invisible se met en ordre : le souffle retrouve sa fluidité, les tissus reprennent leur espace, et le regard du patient change.
Ce n’est pas spectaculaire ; c’est souvent silencieux, mais profondément réel.
7. Conclusion — Le toucher qui relie
La végétothérapie, la psychologie biodynamique, le massage et le yoga thérapeutique ne sont pas des disciplines séparées ; ce sont des chemins différents vers la même intégration : rétablir la continuité entre le corps et la conscience.
Dans ce champ, je me tiens comme un chercheur du vivant, observant comment le corps s’exprime quand il n’a plus à se défendre.
Mon rôle n’est pas de guérir, mais de rappeler au corps qu’il peut se guérir lui-même.
Le corps n’est pas un ensemble de pièces isolées, ni un concept psychologique ; il est un langage qui se parle à travers le souffle, la tension et le silence.
Quand on l’écoute vraiment, on découvre que la thérapie ne consiste pas à corriger, mais à accompagner.
Et si, au fond, la véritable guérison commençait simplement au moment où le corps ose enfin respirer sans se défendre ?
Bibliographie sélective
Sivananda, Swami. The Practice of Yoga. Divine Life Society, 1980.
Boyesen, G. Entre psyché et soma : la psychologie biodynamique. Éditions du Souffle d’Or, 1988.
Lowen, A. Le langage du corps. Payot, 1975.
Boadella, D. L’énergie et le caractère : introduction à la bioénergie reichienne. Aubier, 1981.
Saraswati, S. S. Yoga Chikitsa: Principles of Therapeutic Yoga. Bihar School of Yoga, 1996.

Inspiration du jour
Javi Molero / BioTouch Method®
« Le toucher conscient n’ajoute rien : il révèle.
Ce que le corps tait, il le respire, puis le transforme. »
